L’expérience des années 2000
Temmar a procédé dans l’opacité la plus totale

Jeudi, le président de la République est intervenu, par le biais de son cabinet, dans le débat sur les privatisations que l’on croyait pourtant clos. Il conditionne désormais la cession des actifs publics par son accord préalable. Serait-ce un sursaut qui révèle une grande confusion au sommet de l’Etat dans la perspective d’une présidentielle qui s’annonce d’ores et déjà à couteaux tirés ? Ou bien le chef de l’Etat s’est-il redressé brusquement pour tenter de corriger un pas de danse raté au début des années 2000, lorsque les premières opérations de privatisation, menées par son acolyte, Abdelhamid Temmar, se sont révélées une liquidation de soldes dans un bureau fermé à double tour ? D’une offre initiale de 89 entreprises proposées à la privatisation en 1998, on est passé, quelques années plus tard, à des centaines de sociétés déclarées éligibles aux privatisations. Des holdings se sont morcelés en plusieurs petites entreprises pour faciliter leur privatisation. Elles ont donné lieu à plus de 370 entités qui allaient figurer dans une nouvelle liste d’entreprises privatisables. Celles du bâtiment pesaient pour un tiers dans cette liste d’actifs publics proposés à la vente. A la suite d’interminables délibérations, une nouvelle liste voit le jour, composée de 250 entreprises qui feront l’objet d’appels d’offres lancés à la fois à l’adresse des investisseurs nationaux et internationaux. Ces appels d’offres n’ont concerné par la suite que 67 entreprises, dont une dizaine de surfaces dédiées à la commercialisation des produits alimentaires, 21 hôtels, 23 briqueteries, 12 unités de fabrication de boissons, dont N’Gaous qui s’était révélée une arnaque sans commune mesure, ainsi que les entreprises Filamp et l’ENAG, avons-nous appris auprès de sources proches du ministère de l’Industrie. Des négociations ont démarré avec des investisseurs et ont abouti à la conclusion de contrats dont la valeur annoncée était d’une trentaine de milliards de dinars. Le reste des privatisations, près de 200 entités, était soit négocié dans l’opacité la plus parfaite, soit laissé en jachère, faute de repreneurs. D’autres entreprises ont été incluses par la suite dans la liste du patrimoine à privatiser, dont les Eriad, El Aurassi, Saidal, les ENAD, les entreprises de collecte et de transformation du liège, les entreprises EMB spécialisées dans l’emballage métallique. La privatisation s’était faite par le moyen d’une ouverture partielle du capital, dont certaines ont fini dans le giron de l’actionnaire privé. Cette ouverture du capital de ces entreprises a rapporté à l’Etat à peine 10 milliards de dinars. Des ministres proches de Bouteflika ont voulu inclure dans la liste des grands groupes, à l’instar de Cosider, des banques, à l’image du CPA, lesquels ont échappé belle à cette grande braderie du début des années 2000. Une si maigre moisson… Un ancien Premier ministre que nous avons rencontré a voulu nous faire cette confidence : «Lorsque Chakib Khelil avait intégré le gouvernement de Bouteflika, il avait fait une déclaration à Abdelmadjid Sidi Saïd qui a marqué les esprits.» Il cite : «Il y a une chose à laquelle vous n’allez pas échapper : c’est la privatisation de certaines entreprises publiques, Sonatrach comprise.» Pour les anciens «hommes du Président», c’était un sujet qui leur tenait à cœur. Ces derniers, faut-il le souligner, ont repris à leur compte un projet qui a été initié, déjà sous Liamine Zeroual, par un certain Ahmed Ouyahia, en application de certaines recommandations du Fonds monétaire international (FMI). Ce programme s’est soldé par la liquidation de centaines d’entreprises publiques locales, la reprise de quelques-unes par les travailleurs (environ 30 000) et par une maigre moisson de 21 milliards de dinars. L’Etat s’était séparé également dans les mêmes conditions de près d’un millier d’agences pharmaceutiques publiques pour une bouchée de pain. La moisson dépasse à peine 600 millions de dinars. Ces premières opérations de privatisation n’ont jamais révélé tous leurs secrets, ce qui explique en partie ce déchaînement de passions à chaque fois que le dossier est rouvert. Et c’est à Ahmed Ouyahia que revient cette nouvelle mission, repêché en catastrophe pour mettre en application certaines mesures qui fâchent et qui rappellent les vieux démons des années 1990 et du début des années 2000. Il est rare que l’histoire se répète sous les mêmes auspices. Il est encore plus rare que cette histoire soit faite par les mêmes valets et les mêmes maîtres. Mais voilà qu’avec Ahmed Ouyahia d’un côté et Abdelaziz Bouteflika de l’autre, on dresse la même table, avec les mêmes couverts pour un banquet dont l’objet n’a pas non plus changé. Une affaire au goût de déjà vu. Acculé par une crise financière née de la chute des cours du brut sur le marché mondial, le gouvernement se voit désormais confronté à son incapacité de gérer et de financer des actifs publics entretenus des années durant sous perfusion financière de l’Etat. Le FMI ne cesse d’appeler de tous ses vœux à la cession de certains actifs publics à même de desserrer l’étau sur le budget de l’Etat. Un air de déjà vu C’est l’histoire qui se répète. «Les administrateurs sont généralement d’avis que recourir à un éventail plus large de possibilités de financement, y compris un recours prudent à l’endettement extérieur et la cession d’actifs publics, et donner plus de flexibilité au taux de change, pourrait fournir une marge de manœuvre budgétaire pour opérer un ajustement plus progressif et plus propice à la croissance que celui prévu actuellement et diminuer ainsi son impact sur l’activité économique», lit-on dans les différentes notes de conjoncture du FMI ayant suivi le contre-choc pétrolier de juin 2014. En 2015, sous le gouvernement Sellal, le dossier de la cession des actifs publics a été à nouveau rouvert. Il a été aussitôt pris en charge par la loi de finances 2016, signée par Abdelaziz Bouteflika. Dans son article 62, la loi budgétaire de 2016 stipule ceci : «Les entreprises publiques économiques qui réalisent des opérations de partenariat à travers l’ouverture du capital social en direction de l’actionnariat national résident, conformément à la législation en vigueur, doivent conserver au moins 34% du total des actions ou des parts sociales. A l’expiration de la période de cinq années et après constatation dûment établie du respect de tous les engagements souscrits, l’actionnaire national résident peut lever, auprès du Conseil des participations de l’Etat, une option d’achat des actions détenues par l’entreprise publique économique. En cas d’approbation par le conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans le pacte d’actionnaires ou au prix fixé par le conseil. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire». Le 23 décembre dernier, lors d’une tripartite dédiée à la signature de la charte relative aux Partenariats public-privé (PPP), le Premier ministre relance concrètement l’ouverture du capital des entreprises publiques, acquiesçant ainsi au vœu du chef de l’Etat écrit en crayon feutre dans la loi de finances 2016 (article 62). Cette nouvelle cession d’actifs publics participe à une tentative de réforme à la fois budgétaire et économique, étant donné qu’un certain patrimoine public devient pour le moins encombrant et coûteux. Pour ainsi dire, cette levée de boucliers orchestrée essentiellement par les lieutenants du FLN contre une mesure budgétaire entérinée en 2016 par Abdelaziz Bouteflika cache plutôt un jeu malsain lié à l’élection présidentielle de 2019. Dans cette arène politique chauffée à blanc à quinze mois des joutes électorales, les couteaux sont aiguisés. Le combat politique se fera probablement au détriment des intérêts économiques du pays.
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Autres sites
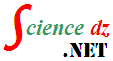
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites