Le coût du non-management politique de l’économie a explosé sous Bouteflika 4

La chronique de la semaine économique algérienne est caricaturale. Elle se résume à l’échange type entre le patron du Medef français, Pierre Gattaz, et le ministre algérien de l’Industrie, Youcef Yousfi. Le premier évoque une liste d’obstacles et demande un signe fort pour relancer les investissements français en Algérie, le second allonge une liste d’avantages acquis et demande de la patience pour le reste. Statu quo. Ce dialogue, déjà entendu ces dernières années, cristallise le coût du non-management politique de l’économie algérienne depuis maintenant près d’une décennie et le coup de froid de la LFC 2009. L’hypercentralisation de la décision de gouvernance économique à la présidence de la République a densifié le maquis bureaucratique et fait monter, à tous les étages de l’immeuble, les coûts de «main levée» pour réaliser un investissement. Sur la bouche du patron des patrons français, on peut bien lire : «On ne se bousculera pas chez vous tant que cela restera pareil». Et sur celle du ministre algérien, on peut comprendre : «Ce n’est pas près de changer, il faudra vous adapter». Le non-management politique de l’économie est une incapacité à rendre en temps et en lieu les arbitrages qui permettent de soutenir une croissance forte et durable de l’activité. Youcef Yousfi n’avait rien à dire de nouveau aux chefs d’entreprise français, si ce n’est que l’Algérie veut s’industrialiser et engager, enfin, une transition énergétique et numérique qui tardent à s’amorcer. Selon quel modèle de sollicitation du capital étranger ? Le même qu’avant. Avoir perdu près de 100 milliards de dollars de réserves de change en un peu plus de trois ans ne modifie rien à l’équation du non-management. C’est à prendre ou à laisser. L’autre incarnation du statu quo persistant est bien sûr le blocage complet sur les privatisations. Leur reprise est économiquement nécessaire pour réduire les charges du budget (refinancements récurrents), faire des recettes exceptionnelles au Trésor (cession) et relancer activité et emploi (redéploiement par les acquéreurs). Mais le non-management politique a jugé le risque tactique trop incertain pour engager quoi que ce soit dans une année charnière préélectorale. Même les dispositions prévues par la loi en cours, comme par exemple la cession de Sonatrach au profit de ses associés, de ses parts sur des blocs exploités en mode de partage de production, devient sulfureuse dans le climat délétère du non-management. La problématique, là aussi, est pourtant claire. Sonatrach n’arrive pas à mobiliser les moyens financiers et techniques pour développer sa partie du contrat sur un bloc exploré et opéré en association. Plus de 3D, plus de forages, plus de délinéations. Elle est, poussée par son actionnaire public, en quête de ressources fiscales ainsi bloquées, tentée de céder cet effort de développement à son associé qui, in fine, paiera la même fiscalité additionnelle que Sonatrach au Trésor, lorsque la production supplémentaire, ou nouvelle, sera là. Voilà un artifice bien utile, dans le contexte de sous-investissement actuel sur le domaine minier algérien. Il a dérapé en levée de boucliers contre la cession des actifs de Sonatrach dans ses filiales. Un faux sujet. La faute, bien sûr, à une grossière erreur de communication de Sonatrach. Ce type d’annonce devant être réservé au CEO et pas à un vice-président. En particulier dans un contexte où la perception de la privatisation — ce qui dans le cas des associations sur l’amont pétrolier n’en est pas tout à fait une — est devenu un marqueur chimique du statu quo politique. Deux illustrations des coûts du non-management politique remontent à la surface dans la chronique des dernières semaines, le renouvelable et Air Algérie. L’ancien ministre de l’Energie, Nourredine Boutarfa, a annoncé à Houston, en décembre 2016, le projet d’un appel d’offres géant pour réaliser 4000 Mégawatts d’électricité solaire en Algérie. Projet ni annulé ni mis en œuvre plus de 13 mois plus tard. Il était pourtant censé engager le rattrapage dans le retard pris par le programme des ENR algérien, visant à atteindre 22 000 mégawatts en 2030. Les atermoiements autour de la publication du cahier des charges ont rythmé tout l’été 2017. Plusieurs motifs supposés du report. Le principal : la fragilité du modèle d’affaires qui oblige les producteurs d’électricité solaire à ramener avec eux les industries des composants de la filière pour un assemblage en Algérie. En fait, il s’avère, selon une source sérieuse, que le report sine die du lancement du cahier des charges pour enfin lancer à grande échelle le programme ENR Dz est lié à une absence d’arbitrage politique en économie. Une de plus. Il faut, en effet, mobiliser les financements de la subvention qui garantit l’achat (avec un surcoût vs filière génération par le gaz) de l’électricité solaire à son arrivée sur le réseau de transport. Personne ne s’y colle. Surtout pas le président de la République qui avait érigé, il y a déjà deux ans, en février 2016, le programme des énergies renouvelables comme priorité stratégique pour le pays. Pas de financement du modèle de transition, pas de programme ENR à large échelle, et pas d’appel d’offres pour cela. Le non-management coûte la poursuite du gaspillage du gaz naturel dans la génération électrique pour laquelle le soleil pourrait prendre largement le relais. Autre illustration : le sort de Air Algérie, revenu au-devant de la scène avec le mouvement social du Personnel navigant commercial (PNC). L’ancien PDG du pavillon national, Mohamed Saleh Boultif (2011-2015), a expliqué à Maghreb Emergent que l’avenir d’Air Algérie est lié au changement de son modèle économique, notamment avec la livraison du nouveau terminal d’Alger. Il s’agit de reprendre le modèle hub dédié qui permet aux grandes compagnies mondiales de trôner sur le trafic international. Air Algérie s’appuierait sur ce terminal au potentiel de 10 millions de voyageurs par an pour assurer une continuité entre toutes ses destinations actuelles et futures. Et sortir du modèle désuet aller-retour. Tout plaide pour cette évolution, esquissée par ailleurs par la RAM à Casablanca avec moins d’atouts logistiques. Bémol. Des prérequis vont manquer à l’appel. D’abord l’organisation d’Air Algérie en groupe et filiales. Ce qui permettrait à la compagnie de se recentrer sur son métier de base, le transport aérien de voyageurs. Là aussi, comme pour les privatisations, le passage au tout-solaire, ou la «décarbonisation» des transports, les résistances ont les lobbies solides. Seul le métier du catering a été sorti d’Air Algérie depuis que le plan de filialisation a été adopté. La maintenance (plus de 2000 employés) ou l’exploitation au sol sont, 3 ans plus tard, toujours en attente de l’être. Faute d’impulsion, le statu quo perdure. Et le risque de voir Air Algérie s’écrouler sous elle-même enfle. Autre prérequis pour engager le modèle compagnie-plateforme-hub, le design initial de l’équipement. Il doit être complètement configuré pour être un lieu de transit. Pour les passagers bien sûr. Mais aussi, et tout autant, pour les bagages. Le non-management de cette exigence laisserait Air Algérie vivoter dans la trappe de l’aller-retour. On sait où elle peut conduire à terme. Alitalia est sur le point d’être rachetée par Lufthansa. Question morale de la semaine : faut il ouvrir une enquête judiciaire sur l’affaire Bouchouareb accusé par le patron du groupe Elsecom de lui avoir demandé indirectement de l’argent ? Il se pourrait fort que cela soit déjà le cas. Une information à charge contre l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines ? La jurisprudence algérienne ne va plutôt pas dans ce sens. L’impunité des ministres et des hauts responsables est la règle. Mais dans le contexte particulier de ce début d’année 2018, peut-être faut-il considérer la donne autrement. En Italie, l’affaire ENI vient de connaître un rebondissement spectaculaire qui remet toute la pression sur l’un des principaux bénéficiaires des largesses de sa filiale Saipem, l’ancien ministre algérien de l’Energie, Chakib Khelil. La corruption comme phénomène consubstantiel à l’accumulation du capital est considéré par la majorité des académiciens comme un frein au développement économique. Pas par tous ? Visiblement pas. Ils ont la tâche difficile de nous convaincre que Bouchouareb et Khelil ont accéléré la croissance de l’industrie et de Sonatrach en rackettant l’entrée sur le marché algérien ou l’investissement des Algériens. Là également, le non-management complice du politique a coûté cher au Trésor public. L’addition est en bas de page.
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Autres sites
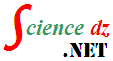
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites