Décryptage. Aux origines du népotisme et populisme qui paralysent l’Etat algérien

La conception de l’État que les textes officiels algériens révèlent est ambiguë : l’État, exalté comme principal instrument « d’édification » du socialisme, est en même temps contesté comme refuge de bureaucrates qui bloquent la volonté révolutionnaire des masses. Sans entrer ici dans ses détails, on se bornera à souligner combien la théorie officielle est conforme à la culture politique dominante de la société algérienne, toute pétrie de contradictions. L’attente de l’État y côtoie la méfiance envers l’appareil administratif.
L’attente de l’État touche l’ensemble de la population. F. Fanon, qui avait bien prévu que la guerre de libération provoquerait « l’émergence du citoyen » à travers une conception de l’État impliquant la participation au pouvoir de toutes les couches sociales, n’en avait pas perçu l’aspect sans doute le plus important : la revendication de la prestation administrative exigée comme un droit.
Le citoyen algérien est avant tout un consommateur agressif, qui attend de l’État national tout ce que l’État colonial lui a refusé. La petite bourgeoisie urbaine lui demande le pouvoir politique et le niveau de vie des anciens colonisateurs, le prolétariat urbain la sécurité de son emploi et l’augmentation de ses salaires, les paysans pauvres le travail et surtout l’instruction, instrument exclusif de la montée sociale, les milieux arabisants traditionnels en espèrent la réanimation de la culture nationale brimée par l’intermède colonial. L’État apparaît à la Société comme la seule « entreprise » efficace, susceptible de faire mieux et plus vite que les initiatives privées, nationales ou étrangères. L’autogestion ne fait pas exception, bien au contraire : la psychologie du producteur y a fait place à celle du salarié qui correspondait mieux à la croyance, contractée dans le passé, que l’administration doit et peut trouver la solution à tous les problèmes.
Les comités de gestion n’ont-ils pas d’ailleurs toujours exigé une aide massive de l’État dans le même temps où ils dénonçaient les interventions excessives et bureaucratiques de ce dernier ? En fait, dans son point de départ, l’autogestion est un mouvement à la fois de prise en mains par les ouvriers de leurs propres affaires et d’appropriation du sol et des entreprises abandonnées par les étrangers. Dans l’esprit de beaucoup d’ouvriers, autogestion se confond avec indépendance, sans plus. Leur propre syndicat est parfois considéré comme une administration.
Une enquête réalisée dans un certain nombre de domaines agricoles autogérés révèle le peu de crédit que les ouvriers accordent au secteur socialiste, par opposition à l’administration. Ainsi l’État algérien se trouve à la convergence de demandes fort diverses. Instrument de récupération des richesses nationales, économiques et culturelles, dispensateur de prestige, d’argent et de travail, il réalise l’idée de Nation et exprime la volonté générale. Dans son effort de réintégration, il exprime à la fois « la nostalgie du fondamental » et « l’élan vers l’avenir », deux valeurs complémentaires indispensables à la société pour lutter contre sa démobilisation.
La nette différence entre les élites et les paysans
Cette attente de l’État n’a ni le même contenu ni la même signification selon les catégories qui l’expriment. La différence est nette entre les élites intermédiaires souvent d’origine urbaine qui peuplent déjà l’appareil d’État, et les paysans pauvres et les demi-chômeurs des villes. Les premiers développent une « idéologie organisationnelle » fondée sur la compétence et la rationalité. Le conflit politique [688] essentiel à leurs yeux, qui opposait l’ensemble de la collectivité algérienne au colonisateur, a été tranché par l’expulsion de ce dernier et la prise en main de l’appareil d’État par l’élite du nationalisme. Celle-ci désire exercer le pouvoir dans l’intérêt de tous. Elle ne se considère donc nullement comme une classe privilégiée, mais comme une élite au service des catégories déshéritées.
Ce type d’attitude est partagé par une très large fraction des moyens et petits fonctionnaires, pour qui la participation à la fonction publique est Tunique moyen d’ascension sociale en même temps que de sécurité professionnelle. Bien que se sentant relativement peu solidaires du pouvoir politique, ils en partagent les valeurs ; le travail, l’instruction, la compétence doivent permettre à chacun d’élever son niveau de vie et de trouver sa place au soleil. Pour les paysans pauvres et les chômeurs urbains au contraire, l’attente de l’État est plutôt une utopie millénariste qui attend tous les bénéfices du monde industriel par le truchement miraculeux d’un État dont cependant on se méfie. Pris dans un monde d’arbitraire et d’irrationalité, le paysan déraciné ne voit pas dans l’État la compétence organisatrice qui donne sens au projet du citoyen, mais l’objet magique d’une revendication agressive toujours prête à se convertir en hostilité.
La culture politique étatiste secrète en effet son contraire. À attendre de l’État la solution de toutes ses contradictions, la société algérienne ne peut manquer d’en éprouver quelques déceptions quand ce dernier se révèle pour ce qu’il est : un entrepreneur encore inefficace et un lieu d’affrontement entre forces contradictoires. La même déconvenue se traduit alors dans un langage différent selon les couches sociales. Les représentants syndicaux de la classe ouvrière, plus ou moins teintés de marxisme, s’en prennent à la « nature de classes » de l’appareil d’État, formule abstraite sans efficacité, mais qui rencontre le sentiment commun dès que sont dénoncés le luxe et les privilèges des nouveaux bourgeois bureaucrates : aussitôt la soif d’égalité porte à accuser l’État et ses fonctionnaires de parasitisme, les technophiles répondent en dénonçant le « népotisme » et les « relations personnelles » qui président au recrutement de l’administration.
Le raisonnement est à peu près le suivant : le pouvoir politique veut le bien de tous mais il est trahi par des fonctionnaires incompétents [689] qui ont accédé à leur poste par le jeu des blocs régionaux ou personnels. En revanche, les moudjahidine (anciens combattants) reprochent à l’État de ne pas fournir assez d’emplois et d’écarter les anciens maquisards au bénéfice de jeunes fonctionnaires « sortis des écoles > et présumés plus compétents : la « technocratie » est alors mise en accusation. Plus généralement, les masses rurales, ou récemment urbanisées, dont la vision quotidienne du fonctionnaire (jeune, « séparé » de la masse par sa fonction et son mode de vie) est fort éloignée de ses critères habituels de respectabilité (vieillesse, moralité, participation à la communauté, etc.) ont tendance à le prendre pour bouc émissaire de leur mécontentement. Face à un État désincarné qui siège à Alger, « l’autre bout du monde », on revient alors à des loyalismes personnels, familiaux, ethniques ou linguistiques que la formation de base donnée en milieu familial porte naturellement à retrouver.
L’État étant trop lointain et trop abstrait, les groupes primordiaux retrouvent un semblant de vigueur. Le jeu est assez subtil : personne n’admet la légitimité des « loyalismes personnels », le « clanisme » et la « bédouinité » (réminiscences khaldouniennes) n’ont pas d’existence reconnue, sinon pour être condamnés. Rien ne serait plus inexact, malgré l’impression fournie par certains articles de journaux, que de considérer la société et l’État comme découpés en fiefs interdisant toute intégration politique à un niveau supérieur.
La féodalité est désavouée, sans la moindre hypocrisie, mais les mécontentements inévitables joints au fait que le parti unique ne permet pas une opposition officielle d’intérêts clairement perçus, confèrent aux clans une existence de réaction. Celle-ci est résiduelle, mais maintient une certaine polarisation anti-étatique. On n’est pas tellement loin de cette confiance absolue dans les relations personnelles que P. Bourdieu remarquait chez les Algériens face à l’administration coloniale. « Si nous ne nous aidons pas entre nous, qui nous aidera ? »
L’héritage colonial
L’ensemble de ces attitudes envers l’État s’explique en grande partie par l’héritage colonial. En situation coloniale, comme Ta rappelé encore F. Fanon, « ce ne sont ni les propriétés, ni le compte en banque qui caractérisent d’abord la classe dirigeante… l’espèce dirigeante est d’abord celle qui vient d’ailleurs, celle qui ne ressemble pas aux autochtones, les autres ». L’idéologie nationaliste exprime alors naturellement le sentiment unitaire d’une collectivité se saisissant à des niveaux divers comme globalement exclue du pouvoir, c’est-à-dire privée du droit à l’existence. Ce qui réalisera d’un coup ce droit, c’est l’État.
Ce dernier est donc à la fois le symbole de l’indépendance en même temps que celui qui lui donnera un contenu. En ce sens l’idéologie nationaliste est inséparable d’une idéologie étatiste. Elle ne l’est pas moins d’une idéologie anti-étatiste car si l’État futur rassemble tous les espoirs, l’État actuel (colonial) polarise toutes les résistances, l’Administration coloniale bien sûr mais aussi toutes les organisations, y compris nationalistes, qui agissent dans le cadre de ses lois. La guerre de libération est perçue par les Algériens comme une rébellion des masses contre l’occupant mais aussi contre l’organisation des partis nationalistes, bureaucratisée et réformiste.
Les deux faces de cette double rébellion n’ont certes ni le même caractère ni la même portée. Il en demeure cependant une idéologie spontanéiste, même si l’institution devenue à la fois partisane et étatique est désormais exaltée. De même que sous l’état colonial, le désir de détruire un appareil étranger n’empêchait pas une sourde admiration pour une administration dont on voulait tirer tous les avantages en attendant de l’imiter, le dévouement que suscite l’état national n’a pas fait disparaître la méfiance envers un appareil qu’on a conscience de ne pas pleinement maîtriser.
Les références constantes, huit ans après l’indépendance, à « l’héritage colonial qui n’est pas adapté à nos besoins », n’ont pas d’autre cause.
On le voit à ces quelques traits, la culture politique algérienne évoque moins le socialisme entendu comme la prise de pouvoir par une classe dotée d’un minimum de conscience que le populisme. Celui-ci souscrit à deux principes fondamentaux : la suprématie de la volonté du peuple, identifiée avec la justice et la moralité, sur toute norme ; l’importance d’une relation directe entre le peuple et ses leaders indépendamment des institutions.
Les ingrédients principaux sont : une croyance quasi religieuse dans la vertu du petit peuple, sain, non dépravé par la ville, ses tentations et ses dirigeants toujours plus ou moins corrompus ; une méfiance incoercible envers ceux qui détiennent le monopole de la culture (« cette sacro sainte technicité » dont le président Ben Bella déclarait « se méfier comme de la peste ») ; le mépris du fonctionnaire et à un moindre degré du politicien. Pour la grande masse, en effet, le système colonial a été vécu comme une sorte de dieu méchant et caché qui s’incarne selon les circonstances dans les « européens », « l’administration », « les espagnols ».
Il en est resté un sentiment de complicité à tous les niveaux contre les coupables mystérieux qui empêchent le peuple de parvenir au bonheur à sa portée, les « bureaucrates », les « impérialistes », etc. Les hommes qui se sont succédé au pouvoir ont pu s’opposer, apparemment, sur tout ; tous ont participé du populisme.
A. Ben Bella l’avouait avec une fausse ingénuité, évoquant l’opération « ramassage des petits cireurs » (pour les envoyer dans des centres d’éducation spécialisée), il expliquait : « Je me résignai donc à faire ce que tout bon économiste condamne. Faute de m’attaquer à la cause, je résolus de m’attaquer à l’effet », et analysant la situation avec la perspicacité que donne la familiarité avec l’homme de la rue, il ajoutait :
Nous avons fait ces opérations (cireurs, hospices de vieillards) parce qu’elles répondaient à une profonde aspiration des masses algériennes. Celles-ci au sortir d’une nuit de 130 ans, après tant d’années où elles s’étaient trouvées méprisées, avaient le besoin de sentir, de voir, de toucher du doigt, la sollicitude à leur égard des autorités algériennes. Comme un enfant qui se réveillant d’un cauchemar demande à être rassuré et dorloté, le peuple algérien attendait affection et attention du premier Gouvernement algérien de l’Algérie [65].Le souci de la compétence, de la moralité, de la « composante humaine » d’un parti dévoyé par des « politiciens carriéristes » si souvent affirmé par le régime du colonel Boumediène, exprime exactement la même attitude.
Le populisme n’est pas contradictoire à l’attente de l’industrialisation, bien au contraire. Il constitue une réponse à la crise de développement que représente la nécessité conjointe de recourir aux techniques du colonisateur tout en rejetant ses valeurs culturelles et politiques. Le retour aux vertus du « peuple » sera l’antidote qui permettra de ne pas être empoisonné par les emprunts, indispensables, aux valeurs étrangères. Les populistes russes, déjà ne raisonnaient pas autrement. H s’agit toujours de réaliser une industrialisation dont l’exemple vient de l’Occident, en évitant les coûts sociaux que Ton y constate et dont on a subi les effets. Le populisme se présente donc comme la recherche d’une synthèse entre les valeurs de base de la culture traditionnelle et le besoin de modernisation.
Par son projet d’identification aux techniques de l’Occident et de différenciation radicale par rapport à ses valeurs culturelles, le populisme algérien évoque bien le « marxisme objectif » dont parle A. Laroui. Dans la lutte des classes, la révolution prolétarienne ne vient-elle pas accomplir et développer les forces productives tout en modifiant complètement les rapports de production ? L’État sous-développé se présente ainsi comme un prolétariat international. Ceci entraîne comme conséquence normale le rejet du marxisme à l’échelon interne car un peuple prolétaire ne peut être qu’un peuple uni, donc sans prolétariat interne. Le marxisme (interne) est l’idéologie d’une société interne divisée en classes antagonistes, le populisme, celle d’une société interne unie par une volonté générale et en conflit avec d’autres sociétés qu’elle accuse de la dominer. Comme tous les populismes, c’est la réaction d’une « province » située à la périphérie du monde industriel et cherchant à en profiter contre la « capitale », c’est-à-dire le centre occidental et « impérialiste » de ce monde, accusé d’en accaparer tous les bienfaits.
Le populisme algérien
Le populisme algérien étant ainsi identifié, il est aisé dès lors de déterminer sommairement pour conclure sa fonction politique. Analysant le rôle de l’idéologie comme « soutien » d’un système politique, D. Easton distingue trois fonctions : la fonction « partisane s évoque les croyances permettant d’organiser l’opinion sur le comportement quotidien des autorités politiques. La fonction de « légitimation » concerne les croyances soutenant ou contestant le régime et le droit des autorités à gouverner. La fonction « communautaire » concerne la persistance ou le changement de la communauté politique.
L’idéologie algérienne, fortement polarisée sur l’identification à la communauté à travers la Nation et l’Islam, a donc une fonction communautaire déterminante. Sa fonction de légitimation est déjà moins sensible car l’ambivalence des attitudes vis-à-vis de l’État diminue l’assiette du régime. Cependant, la puissance intégrative du sentiment national joue là encore pour renforcer les régimes qui ne s’écarteront pas du bien commun du nationalisme déjà dessiné lors du programme de Tripoli. Enfin la fonction partisane est très faible : comme dans nombre de sociétés de transition, l’idéologie a peu de prise sur la politique quotidienne : les changements de personnel ou les variations dans les choix, y compris les choix de planification, n’affectent pas le soutien que la population porte au système. C’est peut-être pourquoi le parti unique, bien que constamment critiqué, conserve une légitimité inégalée : peu importe qu’il fonctionne mal au jour le jour, le soutien que lui apporte le peuple s’adresse au symbole du régime, non au gouvernant réel.
Par Jean Leca, politologue français
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
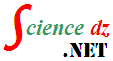
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
