Philosophie en confinement(2)

Il y a longtemps de cela, en faisant nos premiers pas en cours de philosophie, moi et mes camarades, qui ne connaissions rien à cette matière nouvelle pour nous, éprouvâmes quelques appréhensions à affronter cet étrange monde qui échappait totalement à nos mœurs scolaires. Nous croisions souvent ce professeur de philo au regard perdu, les tempes grisonnantes, une pipe toujours collée à sa bouche, l'air serein et débonnaire, mais ce n'était pas de lui que nous avions peur. M. Minne faisait partie de ces personnages indissociables du lycée. Dès que nous nous installâmes, la première chose qu'il fit était de déplier le tableau noir qui nous offrit une liste de livres : «Ce sont des bouquins que vous pouvez acheter à la librairie du cours de la Révolution. Vous les lirez si vous voulez. Moi, je vais vous parler de philosophie, pas de ces cours que le programme officiel vous recommande d'apprendre par coeur.» Alors de quoi allait-il nous parler et quelle sera la nature des cours qu'il nous dispensera ? Comme s'il avait entendu ces questions que nous nous posions dans nos têtes courbées sur nos cahiers vides, M. Minne répondit d'un ton calme, en retirant sa pipe de sa bouche : «Mon cours n'a rien à voir avec ces livres. Moi, je vais vous parler de la vie. Et la vie, c'est la matière première de la philosophie.»
Instinctivement, je pensai à cet auteur qui écrivit un jour que «philosopher, c'est apprendre à mourir» et que nous rencontrâmes en seconde ou en première. Montaigne, un monument de cette Renaissance qui précéda et prépara les Lumières et qui nous fut présenté comme un épicurien, un fou de la joie de vivre, un hédoniste sans limites. Comment cet amoureux de la vie pouvait-il dire une chose pareille ? En vérité, Montaigne sauve l'homme du désespoir : «C’est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être.» C'était bien parti ! M. Minne avait une façon bien à lui de mener ses cours. Il ne les préparait pas, n'avait aucune fiche à la main. Il improvisait, parlant de tout et de rien, profitant d'un titre du quotidien régional An Nasr ou d'une sottise écrite au tableau par un plaisantin, pour dicter le cours du jour. Il arpentait les espaces séparant les rangées de tables en prononçant ses phrases avec aisance et clarté. Nous notions ce qui nous paraissait important. Nous étions désemparés : comment passer le bac avec des cours qui sautillaient des bêtises de Farah aux poèmes de Meziane, en passant par la guerre du Vietnam ou le prochain alunissage d'Apollo ? Tout d'un coup, les fameux livres nous parurent désuets et dépassés par ce voyage didactique aux confins d'une connaissance dispersée, guidée par les événements d'une vie trépidante, collée aux basques d'une actualité galopante, nourrie des turpitudes, des excès ou des ratages monumentaux du réel. Au milieu du second trimestre, la peur disparut. Au diable, les bouquins! M. Minne ne nous apprit rien du programme officiel. Apprendre par cœur les cours de ces livres ne nous aurait menés qu'à répéter les mêmes doctes postulats comme des perroquets. Ce qu'il nous donna était beaucoup plus précieux. Il nous donna la clé pour ouvrir toutes les portes du savoir.
Comme ce bourgeois heureux de découvrir qu'il faisait de la «prose» simplement en parlant, nous sûmes que tout ce que nous disions, tout ce que nous faisions ou ne faisions pas; nos mots, nos silences, nos gestes, nos regards, tout était de la philosophie. Mais contrairement au bougre du Bourgeois gentilhomme de Molière, la connaissance non livresque, ouverte sur la vie de tous les jours, éleva notre compréhension du monde et aiguisa notre conscience. Oui, au diable les livres que l'on apprend par cœur et qui ne servent qu'à bien répondre aux questions, en reproduisant ce que l'on a appris, du «copier-coller avant l'heure ! Nous étions capables de comprendre l'avancée de la science, les avatars de la politiques, les bases de la psychologie, l'histoire de la sociologie non par la théorie mais à travers des exemples puisés dans la vie réelle. Nous en parlions, nous dissertions sur tous les sujets avec facilité mais nous ne pouvions classer ces connaissances dans les cases ordonnées de cette matière appelée «philosophie». Nous nous éloignions de la forme pour aller au fond : sonder la vraie vie, source de toutes les philosophies.
Aujourd'hui, on vous enseigne l'histoire de la philosophie depuis l'Antiquité, les tendances des écoles principales, la biographie des grands philosophes, les axes importants comme la métaphysique, la morale, la raison, la logique, la responsabilité, la psychologie, etc. Mais, à aucun moment, on ne vous apprend à philosopher, c'est-à-dire à vous éloigner des connaissances livresques pour construire votre propre opinion sur un fait précis et l'analyser par vous-même. Si j'évoque aujourd'hui les cours de M. Minne qui pouvaient se déclencher d'une réflexion anodine ou du mot déplacé d'un sacripant, c'est parce que cette extraordinaire leçon de vie est restée dans ma mémoire comme source d'un puissant éclairage illuminant les chemins tortueux de l'existence. Cette nécessité de dominer la scène pour en éclairer les coins les plus sombres, cette soif de compréhension de l'homme, animal raisonnable emporté souvent par ses pulsions, cette faculté à s'élever au-dessus des turpitudes, des mensonges et de l'hypocrisie des hommes politiques, cet amour immodéré de la liberté et de la justice et, probablement, ces cœurs définitivement plantés à gauche de l'échiquier politique ainsi que nos penchants révolutionnaires tenaces et notre persistant esprit rebelle, proviennent de cette période où, à la fin d'une adolescence bercée par la sereine quiétude des années 60, notre esprit et notre conscience furent modelés par cette manière dynamique et engagée de voir la vie.
Un jour, M. Minne nous demanda de définir l'intelligence. Personne n'arriva à le convaincre. Il nous sortit cette explication imprévue : «l'Intelligence est la faculté d'adaptation.» A nos remarques qui liaient cette manière de voir à l'opportunisme, il nous répondit que cette définition lui a été inspirée par l'un de ces premiers robots expérimentaux de ce qu'on appelait alors la «cybernétique» et qui deviendra l'informatique. Ces androïdes acquirent l'intelligence le jour où ils réussirent à prévoir les obstacles et à reculer. Simplement. Un rien et même un fait risible aujourd'hui par rapport aux avancées de la technologie, mais ce premier pas du robot comprenant qu'il fallait reculer devant un obstacle resta ancré dans nos mémoires parce qu'il donnait tout son sens à l'intelligence. Et cet ancêtre de l'intelligence artificielle — dont j'ai oublié le nom — nous aida à avancer dans la vie en faisant marche arrière devant les obstacles pour chercher de meilleurs chemins d'accès.
Sans ouvrir un seul livre de cours, nous nous présentâmes aux baccalauréats algérien et français. Le premier était beaucoup plus difficile que le second car les Français commençaient à introduire l'oral et à alléger les programmes. Avec mes camarades, nous fûmes reçus aux deux bacs. Grâce aux «non-cours» de M. Minne.
Bien plus tard, après cinquante années de journalisme à Annaba et à Alger, c'est auprès d'un autre philosophe que je trouvai le chemin de l'accomplissement de soi. Voltaire, ce philosophe qui rehaussa notre Madaure numide au rang de grande école de philosophie,(*) au même titre qu'Athènes et Rome; auprès de ce philosophe accompli du siècle des Lumières, j'ai retrouvé le chemin de Candide et, à chaque aube naissante qui me trouve en train d'arroser mes fleurs, je pense profondément à cette fin du livre et à l'exigence de «travailler son jardin». Au sens propre, comme au sens figuré, «travaillons notre jardin !»
M. F.
(*) «... Madaure, ville considérable par son commerce, l’était encore plus par les lettres : elle avait vu naître Apulée et Maxime. Saint Augustin, contemporain de Maxime, né dans la petite ville de Tagaste, fut élevé dans Madaure, et Maxime et lui furent toujours amis, malgré la différence de leurs opinions...
«C’est une remarque bien triste, et qu’on a faite souvent sans doute, que cette partie de l’Afrique, qui produisit autrefois tant de grands hommes, et qui fut probablement, depuis Atlas, la première école de philosophie, ne soit aujourd’hui connue que par ses corsaires. Mais ces révolutions ne sont que trop communes : témoin la Thrace, qui produisit autrefois Orphée et Aristote ; témoin la Grèce entière, témoin Rome elle-même.»
(*) Voltaire dans Sophronime et Adélos (notice sur Maxime De Madaure).
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
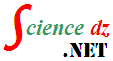
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
