L’économie du savoir
cas de l’Algérie

Par Dr Bachir Chara(*)
Deuxième partie : recherche, formation professionnelle, organisation de l’entreprise et changement des mentalités
Si la formation permet à l’individu d’avoir un cerveau bien structuré, capable de comprendre, d’analyser et de répondre à des défis auxquels il peut être confronté, en proposant des solutions adaptées au contexte dans lequel il évolue et à l’activité qui relève de ses attributions, la recherche scientifique et technique constitue, quant à elle, la cheville ouvrière de tout développement économique. Elle peut être l’œuvre des érudits qui ont de très larges connaissances dans des domaines scientifiques spécifiques, de chercheurs professionnels exerçant dans des institutions spécialisées et des autodidactes bien inspirés ayant acquis une grande expérience dans un domaine précis. Est-ce que telle qu’elle est organisée en Algérie, la recherche scientifique répond à cet objectif ? Les moyens mis par l’État à la disposition de la recherche sont-ils suffisants pour que la recherche soit productive ? Le constat qu’on peut faire avant de répondre à ces deux questions est que la politique adoptée par l’Algérie, dans le domaine de la recherche scientifique et technique, n’a, malheureusement, jusqu’à maintenant, pas permis à la recherche d’être prolifique, en matière de production de brevets, encore moins leur utilisation dans les circuits de production. Ceux qui présentent un intérêt économique avéré ont bénéficié aux entreprises étrangères, qui les ont utilisés pour améliorer leur fonctionnement et augmenter leur production et leur productivité ; ou se retrouvent dans les tiroirs et les étalages des bibliothèques des universités. Les entreprises algériennes se cantonnant dans l’immobilisme qui les a souvent conduites à la faillite.
En effet, l’ouverture du marché algérien à l’importation des produits de consommation a mis en place une concurrence à laquelle les entreprises algériennes ne pouvaient faire face. Cela est aggravé par le fait que l’Algérie s’est placée, depuis le début des années 1990, dans une politique d’import-import. Les causes qui ont conduit à cette situation sont multiples.
La première se rapporte à l’organisation de la recherche. En effet, on a toujours confondu entre la recherche liée à la pédagogie, qui peut déboucher sur des sujets fondamentaux, qui relève normalement des structures universitaires, et la recherche appliquée qui doit s’intégrer dans le tissu économique pour créer de la nouveauté et faire évoluer l’outil de production ; donc deux approches différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Par exemple, en médecine, l’université donne aux étudiants les connaissances fondamentales dans les différentes spécialités médicales, mais c’est au niveau de l’hôpital que les découvertes et les avancées médicales sont réalisées. Par conséquent, la recherche appliquée nécessite des plates-formes pour s’exercer, qui ne sont autres que les entreprises, les terrains d’expérimentation et les laboratoires de recherche. Pour plus d’opérationnalité, ces trois éléments doivent s’intégrer dans des ensembles qui réunissent les équipes de recherche par spécialité. De nombreuses expériences d’organisation de la recherche ont été tentées depuis 1970 avec la création du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), suivie du Conseil provisoire de la recherche scientifique (CPRS) en 1971 et de l’Office national de la recherche scientifique (ONRS) en 1973. Est venu ensuite le Commissariat aux énergies nouvelles en 1982, relayé à partir de 1986 par le Haut-Commissariat à la recherche (HCR), qui a réussi à mettre en place, en moins de trois ans, plus de 400 projets de recherche en sciences exactes et technologie, en science de la nature et de la vie, et en sciences sociales (Khelfaoui H., «La recherche scientifique en Algérie : initiatives sociales et pesanteurs institutionnelles», Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans, Iremam – UMR-CNRS Aix-Marseille Université). Actuellement, 5 centres de recherche, à l’instar du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) ou le Centre de développement des technologies avancées (CDTA), sont impliqués dans la recherche scientifique et technique, en plus des laboratoires logés au sein des universités et centres universitaires. Malgré toutes ces tentatives d’organisation de la recherche, très peu d’articles ont été produits. En 1997, les bases de données françaises (Pascal) et américaine (ISI) s’accordent pour classer l’Algérie au 7e rang africain en matière de production scientifique avec 170 articles scientifiques recensés, contre 1 462 pour l’Afrique du Sud, 1 190 pour l’Égypte, 475 pour le Maroc, 454 pour la Tunisie, 441 pour le Nigeria et 263 pour le Kenya (Waast R. et Arvanitis R., La Science en Afrique à la fin du XXe siècle, vol. 1, Dossier bibliométrique, document IRD, 1999 p. 7). Il s’agit là surtout de publications destinées à promouvoir la carrière des enseignants universitaires que d’apporter des solutions aux problèmes économiques. Il faut toutefois noter que, de 2011 à 2018, le nombre de dépôts de brevets a été dans une évolution ascendante, il est passé de 102 en 2011 à 162 en 2018 ; c’est déjà un bon signe, mais pas suffisant comparativement à ce qui est produit dans d’autres pays en 2018, à l’instar de l’Afrique du Sud, 1861 ; l’Égypte, 1 174 ; le Maroc, 337 ; la Tunisie, 201 (OMPI, statistiques de produits d’invention par pays). Le nombre de demande de brevets déposés n’est pas nécessairement celui qui serait délivré : exemple, en 2018, sur 152 demandes de brevets déposées, il n’y a eu que 27 brevets de délivrés (OMPI). Il semble que la formule, qui permet une meilleure rentabilité pour la recherche développement a enfin été trouvée avec les centres de recherche, qui doivent bénéficier de plus d’égards sur le plan financier.
Ayant été, à la fin des années 1990, de 0,28% du PIB (H. Khelfaoui), le budget de la recherche scientifique et technique n’est que de 0,63%, ce qui est très en deçà de la moyenne de certains pays émergents qui tourne autour de 1,5% (déclaration du directeur de la recherche scientifique et du développement des technologies, le professeur Hafid Aourag, Algérie 360° : Économie – Algérie). Pour s’inscrire dans une dynamique de développement de la recherche scientifique, technique et technologique, l’Algérie doit, par conséquent, mobiliser plus de moyens financiers.
Il faut noter que, dans le passé, 70% des projets de recherche revenaient aux enseignants universitaires et 30% aux autres institutions et entreprises intervenant dans la recherche ; ces proportions doivent nécessairement être inversées pour mettre la recherche au cœur du développement économique. Cela ne remet en rien en cause le rôle que doivent jouer les structures universitaires dans la recherche, simplement dans le contexte actuel de l’économie algérienne, il faut accorder plus d’importance à la recherche développement qu’à la recherche académique. Il faut préciser dans ce cadre, que le financement de la recherche se fera désormais par objectif (déclaration du directeur général de la recherche scientifique au MESRS, journal El Watan, 22 janvier 2020), alors que tout le personnel enseignant des universités perçoit une prime de recherche. Est-ce qu’on va retirer cette prime à ceux qui ne seraient plus impliqués dans les activités de recherche ?
Le deuxième volet qui impacte la recherche au niveau des universités est la surcharge en étudiants. En effet, les enseignants-chercheurs ne savent plus où donner de la tête. Le taux d’encadrement s’est gravement détérioré au fil des ans, il est passé d’un enseignant pour 8,4 étudiants en 1985 à un enseignant pour 29 en 2000. Pour les enseignants de rang magistral, ce taux est passé, dans le même temps, d’un enseignant pour 78 étudiants à un enseignant pour 212 étudiants (Khelfaoui H.). Selon les aveux du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce dernier chiffre atteindrait, pour certaines spécialités, un enseignant pour 600 étudiants (déclaration faite à la presse lors de la rentrée universitaire 2000-2001). Ce chiffre est probablement très largement dépassé de nos jours. La qualité de la formation se trouve, par conséquent, énormément affectée, d’autant plus que les cours magistraux sont souvent dispensés par des titulaires de magistère, qui représentaient à la fin du siècle dernier 77% du personnel pédagogique des universités. Qu’en est-il aujourd’hui ? La situation s’est certainement dégradée davantage, du fait de la multiplicité des universités et centres universitaires (100 environ à travers le territoire algérien) créés entre-temps.
La déclaration de l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Chems Eddine Chitour, qualifiant de nul le niveau des enseignants universitaires, qui a suscité toute une polémique et des réactions musclées des enseignants du Cnes, a probablement une part de vérité. Il fallait peut-être ne pas généraliser, du fait qu’il existe au sein des universités algériennes des enseignants de rang magistral de très haut niveau, qui constituent toutefois une infime minorité.
Le troisième élément qui freine cette activité fondamentale dans l’économie du savoir sont les salaires alloués aux enseignants-chercheurs, qui restent faibles par rapport à ce que perçoivent leurs homologues des pays africains, notamment marocains et tunisiens, que dire des Sud-Africains et des Nigérians. Même des pays moins riches que l’Algérie octroient à leurs chercheurs des salaires plus conséquents. Y avait-il là une volonté des pouvoirs publics de freiner la recherche scientifique et technique et par conséquent le développement du pays, où bien le faisaient-ils par ignorance de ce qu’elle peut apporter comme plus-value à l’économie du pays ? Il est plus probable que ce soit la deuxième partie de la question, sans écarter totalement la première, qui détermine ce comportement, car cela n’est pas le propre des enseignants universitaires et des chercheurs, du fait que toutes les autres professions sont mal rémunérées. Les dirigeants du pays ont toujours ignoré le fait que c’est l’homme qui créait la richesse et non la machine. Ils ont consenti d’énormes investissements dans les équipements, sans accorder beaucoup d’attention au pouvoir d’achat de ceux qui devaient les faire tourner. Il est arrivé que de nombreux équipements aient été importés, à prix d’or, sans qu’ils soient exploités et même utilisés par manque de personnel qualifié et des problèmes sociaux auxquels il est confronté. L’équation est simple, les personnels intervenant dans tous les secteurs d’activité se retrouvent, souvent, entrain de chercher les moyens de subsistance pour nourrir leur famille que de s’impliquer entièrement dans les professions qu’ils exercent. Ce qui est malheureux c’est de constater que certaines voix s’élèvent actuellement pour demander à l’État de réduire les salaires de certaines professions, alors qu’elles sont les moins rémunérées par rapport à ce qui est pratiqué dans les pays de la région et même dans toute l’Afrique. On se demande comment fonctionnent ces esprits rétrogrades, imprégnés de réflexes du Moyen-Age.
Ils veulent revenir à une certaine époque où un président de la République avait déclaré qu’il allait faire en sorte que les riches du pays deviendraient aussi pauvres que les pauvres, sous acclamations populaires. Si à l’époque cela pouvait être accepté par un peuple, qui sortait du colonialisme, avec très peu de capacités intellectuelles, il est vraiment regrettable que de pseudo-intellectuels pensent, en ce temps, de manière similaire.
Un professeur français, militant du Parti socialiste, ayant acquis en 1984 une voiture Mercedes de dernière génération, apostrophé par un de ses étudiants, de nationalité algérienne, qui lui disait comment un socialiste se permettait d’être propriétaire d’une telle voiture, a répondu de façon plus que cinglante : il lui a rétorqué que le socialiste français n’est pas comme l’Algérien, il travaille pour que tous ses concitoyens roulent en Mercedes. C’est à méditer.
Le quatrième composant qui ankylose la recherche scientifique et technique se rapporte aux équipements et à la documentation dont doivent disposer les chercheurs algériens, qui ne sont en rien comparables à ceux qui se trouvent dans les laboratoires d’outre-mer. Même si les universitaires algériens bénéficient de stages annuels qu’ils effectuent dans des laboratoires des pays occidentaux, d’une durée de 30 jours et même quelques mois pour les doctorants, et que ce temps imparti n’est pas entièrement utilisé pour la documentation et la recherche, car certains l’utilisent pour le tourisme et le shopping, il s’avère néanmoins insuffisant pour acquérir les nouvelles avancées scientifiques et technologiques. D’ailleurs, cela n’est pas le cas des chercheurs qui exercent dans les centres de recherche, qui ne relèvent pas du MESRS. Ce qui serait préférable c’est de doter les universités et les centres de recherche d’équipements et de documentation indispensables à leurs travaux. Un centre national légué à l’acquisition des ouvrages techniques et scientifiques édités annuellement dans le monde serait probablement la solution à la constitution d’un fonds documentaire national qui servira à la recherche et à la formation universitaire.
La cinquième et dernière contrainte est celle consistant, dès le départ, à viser des objectifs, qui, souvent, se révèlent infructueux. Beaucoup de découvertes et inventions sont liées au hasard. Ne dit-on pas que le hasard fait parfois bien les choses ? Les chercheurs ne doivent en aucune manière être conditionnés par des thèmes préalablement définis. Cela doit être le cas pour des études doctorantes, mais pas pour la recherche opérationnelle qui doit rechercher les solutions à des problèmes posés et améliorer les processus de production dans les différentes filières économiques. La politique adoptée par le MESRS en matière de recherche scientifique et technique prête à équivoque, notamment pour ce qui de la recherche opérationnelle du fait que les budgets sont alloués pour des thèmes de recherche définis à l’avance. Pour les centres de recherche qui travaillent sur des thématiques spécifiques, il serait souhaitable que les subventions soient globales et non compartimentées par sujet de recherche, ce qui donne la latitude aux gestionnaires d’opérer des transferts de fonds d’un chapitre à un autre, en fonction de l’état d’avancement des recherches et des besoins financiers y afférents, et ce, pour éviter tout blocage qui pourrait être lié à la non-disponibilité de liquidités.
À elles seules, la formation supérieure et la recherche ne peuvent assurer une économie du savoir efficiente, si leurs produits ne sont pas :
- mis en œuvre dans des entreprises régies par une organisation efficace ;
- exécutés par un personnel qualifié et ayant une mentalité constructive.
Il revient donc à la formation professionnelle de jouer un rôle important dans ce sens, en mettant à la disposition des secteurs économiques des effectifs de travailleurs répondant aux besoins réels des entreprises relevant des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Elle doit, par conséquent, être continuellement à l’écoute des entreprises pour connaître leurs besoins en ressources humaines. Un partenariat avec les différents secteurs d’activités économiques est nécessaire, ayant pour finalité la formation à la carte, dont le personnel ainsi formé sera placé au niveau des entreprises qui auraient préalablement participé à sa formation et où il s’intégrera rapidement.
La formation professionnelle doit donc sortir des activités routinières pour s’inscrire dans l’évolution permanente qui caractérise les activités économiques d’aujourd’hui, à savoir des changements rapides dans les techniques de production, avec ce que cela implique comme nouveaux instruments introduits dans les procédés de fabrication.
En matière d’organisation, l’entreprise doit fonctionner dans un climat économique sain, sans qu’il y ait d’interférences politiques dans sa gestion, son organisation et son fonctionnement. Il revient donc à ses administrateurs de prendre les décisions les plus adaptées à son fonctionnement, qui assurent la meilleure rentabilité de ses investissements. Malheureusement, cela n’est pas le cas des entreprises publiques où le politique prédomine sur l’économique, notamment en matière d’embauche. Dans ce cadre, le cas d'Air Algérie est très significatif. Cette compagnie d’État emploie 9 565 personnes pour une flotte de 59 appareils (chiffres de janvier 2018) alors que, selon les professionnels des transports aériens, ses besoins en personnel ne doivent nullement dépasser un effectif de 3 000 personnes. La lourdeur de sa masse salariale ne lui permet en aucune manière d’investir et de se développer sans l’aide du Trésor public. Elle ne doit d'ailleurs sa survie qu’au renflouement de ses caisses par ce dernier. Alors que, compte tenu de la position géographique de l’Algérie, Alger aurait pu devenir un hub pour relier l’Afrique au reste du monde et inversement. De très nombreuses entreprises publiques ont été également victimes des sureffectifs et ont mis, comme dit l’expression, les clés sous le paillasson, mettant des centaines de milliers de personnes au chômage avec des pertes incalculables pour leTrésor public. Cette situation va se compliquer davantage avec la pandémie de Covid-19 qui va très certainement durer, comme l’a souligné le directeur général de l’OMS le 1er août 2020, et qui va très probablement mettre en faillite les quelques entreprises étatiques, qui ont résisté aux aléas antérieurs, si le Trésor public n’intervient pas à nouveau pour les consolider financièrement, ce qui paraît difficile, pour le moment, en raison de la crise économique à laquelle le pays fait face. Si cela est évoqué ici, c’est pour dire que les gestionnaires des entreprises se retrouvent mains liées face à cette situation du moment qu’ils ne peuvent procéder à des dégraissages d’effectifs.
Il n’y a pas que le sureffectif qui impacte le développement des entreprises étatiques, le manque de liberté dans leur gestion quotidienne est également un élément de blocage. En effet, les gestionnaires ont souvent tendance à s’adresser à la tutelle avant de prendre une quelconque décision relative au fonctionnement ou à l’investissement, et ce, afin de se protéger des déboires juridiques éventuels ; mais les réponses se font souvent attendre. Les gestionnaires des entreprises publiques ne prenaient par conséquent plus d’initiatives, durant les dernières décennies, après que beaucoup d’entre eux ont payé un lourd tribut, parfois à tort, sous le premier gouvernement d’Ahmed Ouyahia. Ajouter à cela la pénalisation du risque qui constituait une épée de Damoclès sur la tête des gestionnaires, avant l’amendement du code de procédure civile dépénalisant l’acte de gestion. Ce qui fait que le gestionnaire n’était là que pour gérer les affaires courantes et même à ce niveau, il est souvent contraint d’appliquer des instructions qui émanent de ses supérieurs hiérarchiques, pour ne pas se faire débarquer de son poste. Ces injonctions sont la plupart du temps transmises oralement, plaçant le gestionnaire dans des situations compliquées sur le plan juridique. Cet état de fait met l’entreprise dans un état d’immobilisme qui bloque son développement et la mène, parfois, à la faillite, ce qui a d’ailleurs détruit le tissu industriel algérien.
Avec toutes les mesures énumérées ci-dessus, si on n’engage pas dès à présent un chantier visant le changement des mentalités acquises par les Algériens durant les cinquante-huit années d’indépendance du pays, ni la formation ni la recherche encore moins la pléthore des lois de la République ne pourraient rendre efficiente l’économie du savoir. Le manque d’engagement des Algériens dans le travail, quand ils exercent dans des entreprises publiques, est caractéristique. Travailler quatre heures par jour sur les huit heures réglementaires relève déjà de l’exploit. Aux horaires des prières de la journée, qui doivent normalement prendre cinq, voire 10 minutes chacune, les fidèles travailleurs mettent parfois une heure pour chacune d’elles, sans compter les pauses-café et le déjeuner qui prennent également leur quota de temps. Additionnellement à cela les arrivées après et les départs avant les horaires de travail sont des pratiques coutumières chez le travailleur ou le fonctionnaire algérien. Ce personnel ne considère pas qu’il travaille pour lui et que tout manquement, de sa part, met l’entreprise en danger et par voie de conséquence son poste de travail. Mais du fait qu’on lui a toujours claironné que la Constitution lui garantissait le travail, il se croit protégé. Pire, il considère que l’outil de production sur lequel il exerce sa profession appartient, comme le disent les Algériens, dans leur grande majorité, au «beylik», ce qui veut dire l’État. Il pourrait par conséquent faire de lui ce qu’il voudrait sans qu’il soit blâmé par personne. Il oublie ou bien ignore que lui-même fait partie de l’État, que cet outil de production est le sien. Cette façon de penser est ancrée dans l’esprit des gens et a des liens historiques avec la période coloniale, notamment pendant la guerre de libération durant laquelle il fallait détruire tout ce qui appartenait au colonisateur. D’ailleurs, même après l’indépendance du pays tous les vestiges coloniaux, même ceux qui pouvaient avoir une valeur historique et touristique, ont été détruits. Ils voulaient effacer une histoire pourtant indélébile et avec un patrimoine touristique qui, aujourd’hui, aurait pu rendre service au pays.
Les Espagnols n’avaient-ils pas gardé l’Alhambra qui, de nos jours, draine des millions de visiteurs par an et tous les millions d’ouvrages scientifiques qui ont fait l’essor du monde occidental d’aujourd’hui. C’est vrai que le colonialisme a fait énormément de mal aux citoyens algériens, mais ne fallait-il pas utiliser le bon sens et agir de façon intelligente pour préserver l’histoire et ne pas vouloir l’effacer ? On oublie que c’est l’histoire d’hier qui façonne l’homme d’aujourd’hui et de demain. Même sur le plan éducatif, n’était-il pas mieux de conserver dans les programmes scolaires l’éducation civique et l’éducation morale pour former des citoyens qui maintenant seraient respectueux des lois de la République, protègent le patrimoine de la communauté, témoignent de la considération pour autrui et font du bien pour le bien et non pour recevoir des récompenses en contrepartie ? Malheureusement, les gouvernants des années 1970, avec leur engouement révolution ont voulu prendre une revanche sur l’histoire au lieu de l’apprivoiser pour un meilleur bien-être des Algériens, sans prendre en considération la sociologie de leur peuple. Ils ont remplacé ces matières par l’éducation religieuse dispensée par des enseignants qui n’avaient comme références pédagogiques que l’apprentissage du Saint Coran, qu’ils ne pouvaient expliquer ni sa complexité spirituelle ni sa portée sociétale. Cela a d’ailleurs produit le fanatisme de la décennie noire et le fatalisme vis-à-vis de la pandémie de Covid-19 qui touche le pays actuellement et qui ne fait que s’aggraver, en raison du comportement scandaleux de certains citoyens, que l’État laisse faire, car il ne pouvait ou ne voulait appliquer les mesures qu’il prend en matière de confinement, de port du masque ou de distanciation, cumulées avec l’incapacité des structures hospitalières et leur préparation à prendre en charge tous les malades.
Il est clair qu’on ne peut prétendre aller vers l’économie du savoir avec une telle composante humaine, si des mesures radicales et non discriminatoire ne sont pas prises très rapidement par les pouvoirs publics. Celles-ci doivent viser la rentabilité économique, sans se démarquer entièrement des aspects sociaux et sans verser dans le clientélisme, le népotisme et le favoritisme.
B. C.
(*) Ex-vice-président de l’Assemblée populaire nationale. Ex-président de la Commission de l’économie rurale, de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Parlement panafricain.
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Autres sites
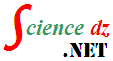
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites