Fuite de 15,8 millions de comptes PayPal sur le dark web, que risquent vraiment les utilisateurs ?

Début août 2025, une annonce secoue l’univers de la cybersécurité et de la fintech : des millions d’identifiants PayPal seraient proposés à la vente sur le dark web. Baptisé « Global PayPal Credential Dump 2025 », ce lot de données pèse 1,1 Go et contiendrait les informations de près de 15,8 millions de comptes utilisateurs. Le tout vendu pour la somme dérisoire de 750 dollars.
L’affaire, largement relayée par des médias spécialisés tels que Cybernews, Hackread, Neowin ou encore Bitdefender, soulève de nombreuses interrogations. Les données sont-elles réellement nouvelles ? PayPal a-t-il subi une nouvelle brèche de sécurité en mai 2025, comme le prétend le vendeur ? Ou bien s’agit-il d’une revente de données issues d’incidents passés, notamment l’attaque par credential stuffing de 2022 évoquée par PayPal ?
Au-delà du factuel, cette affaire remet en lumière une question plus large : les plateformes de paiement en ligne sont-elles véritablement sécurisées ? Cet article propose une analyse complète de cette affaire, replacée dans son contexte technique et réglementaire, avec des conseils pratiques pour les utilisateurs soucieux de la sécurité de leurs données.
Le « Global PayPal Credential Dump 2025 » : une fuite massive
Selon les différentes publications, la fuite concernerait 15,8 millions d’identifiants PayPal, comprenant :
adresses e-mail des utilisateurs,
mots de passe en clair,
parfois des URLs associées, indiquant si l’accès provenait de la version web ou mobile de PayPal.
Le fichier serait proposé à 750 dollars, un prix étonnamment bas si l’on considère la valeur que pourraient représenter des millions de comptes PayPal actifs. Cette donnée seule incite à la prudence : il pourrait s’agir d’un mélange de données anciennes, partielles, voire de doublons.
Plusieurs experts, dont ceux de Bitdefender, estiment que la structure des données pointe plutôt vers une origine liée à des malwares de type infostealer, conçus pour siphonner les identifiants stockés sur les navigateurs ou systèmes compromis, plutôt qu’à une faille directe dans les serveurs de PayPal.
La version officielle de PayPal
Face à l’emballement médiatique, PayPal a rapidement publié une réaction officielle. Selon l’entreprise, ces données ne proviendraient pas d’une nouvelle faille mais d’une ancienne attaque par credential stuffing survenue en 2022. Cette technique consiste à exploiter des bases de données d’identifiants volés sur d’autres sites, pour les tester automatiquement sur PayPal, dans l’espoir que des utilisateurs aient réutilisé le même mot de passe.
En 2022, PayPal avait reconnu qu’environ 35 000 comptes avaient été touchés par ce type d’attaque. L’entreprise insiste sur le fait qu’aucune intrusion directe dans ses systèmes n’a été détectée depuis.
Cependant, cette explication ne convainc pas tout le monde. Le vendeur à l’origine du dump, sous le pseudonyme Chucky_BF, affirme que les données sont récentes (mai 2025). Aucune preuve tangible ne permet de trancher entre la thèse officielle et celle du vendeur.
L’amende de janvier 2025 : un contexte défavorable
Quelques mois seulement avant cette nouvelle polémique, PayPal avait déjà fait les gros titres. En janvier 2025, le New York Department of Financial Services (NYDFS) a infligé à l’entreprise une amende de 2 millions de dollars. Motif : des manquements dans la gestion de la cybersécurité, qui avaient conduit à l’exposition de données sensibles d’utilisateurs (noms, adresses, numéros de sécurité sociale, etc.) lors d’un incident en décembre 2022.
Selon les régulateurs, l’incident de 2022 avait été aggravé par plusieurs défaillances internes :
absence de procédures robustes de gestion des risques,
formation insuffisante du personnel,
non-application de l’authentification multifacteur sur certains flux internes.
Même si PayPal a depuis renforcé sa sécurité, la répétition des polémiques fragilise l’image de fiabilité que doit inspirer une plateforme de paiement de cette envergure.
Données fraîches ou recyclées ? Une polémique non résolue
Le point le plus controversé reste l’origine exacte des données. Trois hypothèses sont actuellement sur la table :
Un recyclage de données anciennes : les informations proviendraient bien d’incidents passés, notamment de 2022, et seraient revendues comme « nouvelles » pour attirer acheteurs et journalistes.
Une nouvelle fuite en mai 2025 : thèse défendue par le vendeur, mais sans éléments techniques probants publiés.
Une collecte via infostealer : des malwares installés sur des appareils compromis auraient siphonné les identifiants enregistrés dans les navigateurs des utilisateurs. Cette hypothèse expliquerait la présence de mots de passe en clair et de données associées aux URLs.
La troisième option est jugée la plus plausible par de nombreux chercheurs en cybersécurité. Elle rappelle qu’une grande partie des vols d’identifiants ne provient pas directement des serveurs des entreprises, mais de l’écosystème périphérique — ordinateurs, smartphones, extensions de navigateur, etc.
Les risques concrets pour les utilisateurs
Qu’elles soient fraîches ou recyclées, ces données exposées représentent un danger pour les utilisateurs de PayPal. En cas de compromission, les risques sont multiples :
Accès direct aux comptes PayPal : possibilité d’effectuer des paiements, transferts d’argent ou retraits.
Fraude sur les comptes bancaires liés : PayPal étant souvent relié à une carte bancaire ou un compte courant, le risque de fraude s’étend au-delà de la plateforme.
Phishing ciblé : les adresses e-mail volées peuvent être utilisées pour envoyer des campagnes de phishing personnalisées.
Revente sur d’autres forums : même si l’acheteur initial n’exploite pas les données, elles peuvent circuler dans d’autres réseaux cybercriminels.
La fuite d’identifiants en clair est particulièrement préoccupante : elle signifie que les mots de passe n’ont pas été hachés, ce qui les rend immédiatement exploitables.
Les plateformes de paiement en ligne sont-elles sûres ?
La question dépasse le cas PayPal. Les services de paiement en ligne (PayPal, Stripe, Revolut, Wise, etc.) sont soumis à des exigences réglementaires fortes en matière de sécurité. Ils investissent massivement dans la cybersécurité : chiffrement des données, détection d’anomalies, authentification multifacteur, conformité PCI DSS.
Cependant, la sécurité absolue n’existe pas. Les principaux vecteurs de risque sont :
La réutilisation des mots de passe : un problème récurrent chez les utilisateurs.
Les malwares infostealers : capables de récupérer identifiants et cookies de session directement sur les machines compromises.
Les attaques par phishing : qui contournent la technologie en visant l’humain.
Les erreurs humaines internes : comme l’a montré l’incident de 2022 chez PayPal.
En pratique, les grandes plateformes sont généralement plus sécurisées que de nombreux sites e‑commerce ou services en ligne, mais leur rôle central en fait des cibles privilégiées pour les cybercriminels.
Conseils pratiques pour sécuriser vos comptes PayPal et autres services
Face à ces menaces, les utilisateurs disposent de plusieurs leviers pour renforcer leur sécurité. Voici les principaux :
1. Utiliser des mots de passe forts et uniques
Au moins 12 caractères.
Mélange de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.
Ne jamais réutiliser le même mot de passe sur plusieurs services.
Recourir à un gestionnaire de mots de passe pour stocker et générer des mots de passe complexes.
2. Activer la double authentification (2FA/MFA)
PayPal propose la validation via SMS ou via application d’authentification.
L’option la plus sûre reste l’utilisation d’applications comme Authy ou Google Authenticator, plutôt que le SMS seul.
3. Vérifier régulièrement l’activité de votre compte
Consulter l’historique des transactions.
Vérifier les appareils et sessions connectés.
Recevoir des notifications en cas de connexion ou transaction.
4. Protéger ses appareils
Installer et maintenir à jour un antivirus.
Éviter d’installer des logiciels piratés ou de provenance douteuse.
Mettre à jour régulièrement son système d’exploitation et ses navigateurs.
5. Se méfier du phishing
Ne jamais cliquer sur un lien reçu par e-mail ou SMS prétendant provenir de PayPal.
Vérifier l’adresse de l’expéditeur et l’URL du site avant d’entrer ses identifiants.
Activer les filtres anti‑phishing proposés par certains navigateurs et solutions de sécurité.
6. Limiter les liens financiers
Utiliser une carte bancaire virtuelle ou un compte secondaire pour limiter l’exposition en cas de fraude.
L’aspect réglementaire : vers un renforcement des obligations
Cette affaire illustre également la pression croissante des régulateurs sur les acteurs de la fintech. Les autorités américaines et européennes exigent :
La mise en place de systèmes MFA robustes.
La surveillance en temps réel des anomalies.
Des plans de réponse aux incidents.
Des amendes en cas de manquement.
En Europe, la directive DSP2 impose déjà l’authentification forte (Strong Customer Authentication). Aux États-Unis, le NYDFS mène la danse avec ses exigences strictes, comme l’a montré l’amende contre PayPal en janvier 2025.
À terme, les régulateurs pourraient exiger la généralisation de l’usage d’authenticators matériels (clés FIDO2) pour les services de paiement.

Les 10 pays les plus chers au monde pour vivre
Quiconque envisage de voyager et de visiter de nouveaux pays, villes et civilisations, ou de s'installer dans un nouveau pays, et de commencer une vie différente de celle qu'il menait auparavant, devrait lire ce rapport avant de faire quoi que ce soit, car vous pourriez être choqué de connaître le coût de vie dans certains de ces pays très petits et moins connus du monde. Voici une liste des 10 pays les plus chers à vivre dans le monde, basée sur les frais d'hébergement et de subsistance d'une personne vivant dans la capitale de chaque pays, et selon la population.
Tourisme: 10 villes moyennes pour s’évader en France
Voici une compilation de 10 villes moyennes pour s'évader en France.
Les photos d'animaux les plus droles!
Voici une compilation de photos réelles d'animaux capturées dans des positions droles.
Tourisme: 7 pays que vous pouvez visiter cet été sous conditions
La vaccination contre le virus Corona (Covid-19) pourrait ouvrir les portes de voyages dans de nombreux pays cet été. Quels sont les pays les plus en vue qui ont annoncé l'ouverture de leurs portes aux touristes au cours de la période à venir?
Les 10 pays les plus peuplés du monde en 2100
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) prédit dans son dernier rapport que la population mondiale en 2100 sera de 10,88 milliards. Les pays les plus peuplés du monde ne seront plus les mêmes qu’aujourd’hui.- فرنسا تشتعل بالاحتجاجات: خطة تقشفية تُسقط الحكومة وتفجر الشارع
- تيرصام تكشف أسعار شاحناتها المنتجة محلياً وتعلن موعد انطلاق البيع
- بدأ صرف منحة السفر للمواطنين ابتداءً من 20 جويلية 2025
- الجمارك الجزائرية تعتمد أسعارا مرجعية حسب المنشأ للمركبات المستوردة 2025
- فرنسا والقوى السياسية الرئيسية في كاليدونيا الجديدة توقع اتفاقًا "تاريخيًا" لإعادة تأسيس الوضع المؤسسي للأرخبيل
- شركة ASL Airlines تطلق خطاً جوياً مباشراً بين تولون والجزائر خلال الموسم الصيفي
- صيدال توسّع آفاقها الإفريقية بتصدير 220 منتوجًا صيدلانيًا إلى موريتانيا وتستهدف ثماني دول أخرى
- ستيلانتيس تُسرّع وتيرة استثمارها الصناعي في الجزائر عبر علامة فيات
- اليورو يعود إلى الارتفاع في السوق السوداء أمام الدينار
- استثمار استراتيجي بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات هيونداي في الجزائر
- الموسم الصيفي 2025: رفع الحظر عن السيارات ذات أكثر من 7 مقاعد في موانئ الجزائر ووهران
- مايكروسوفت تُغلق خدمة سكايب رسميًا وتُحوّل المستخدمين إلى تيمز
مواقع أخرى
-

Babalweb إعلانات
أعلن هنا مجانا -
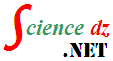
Le site des sciences en Algérie -
Vous cherchez un emploi?
Essayer la recherche d'emploi en Algérie